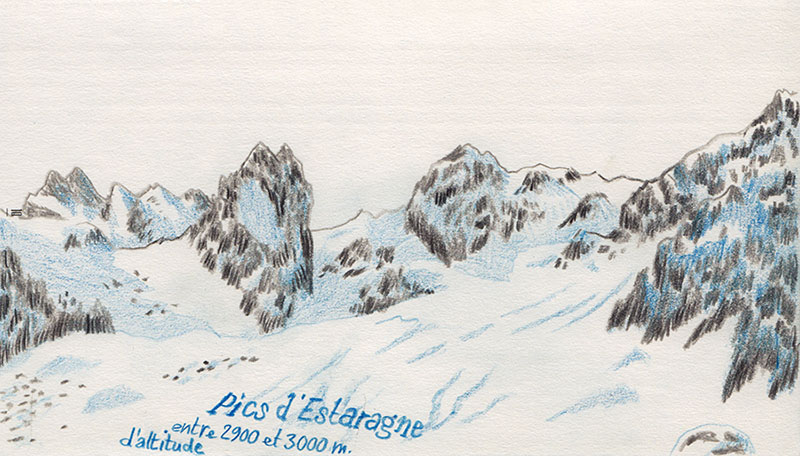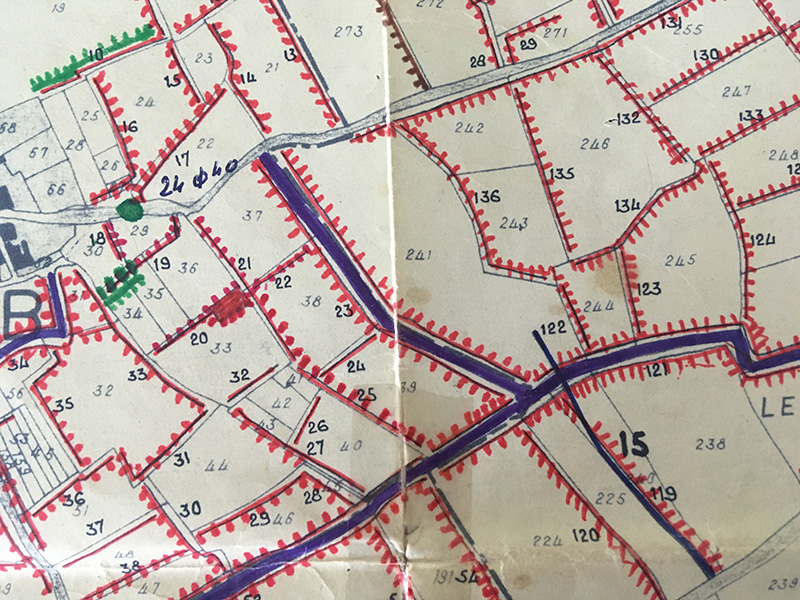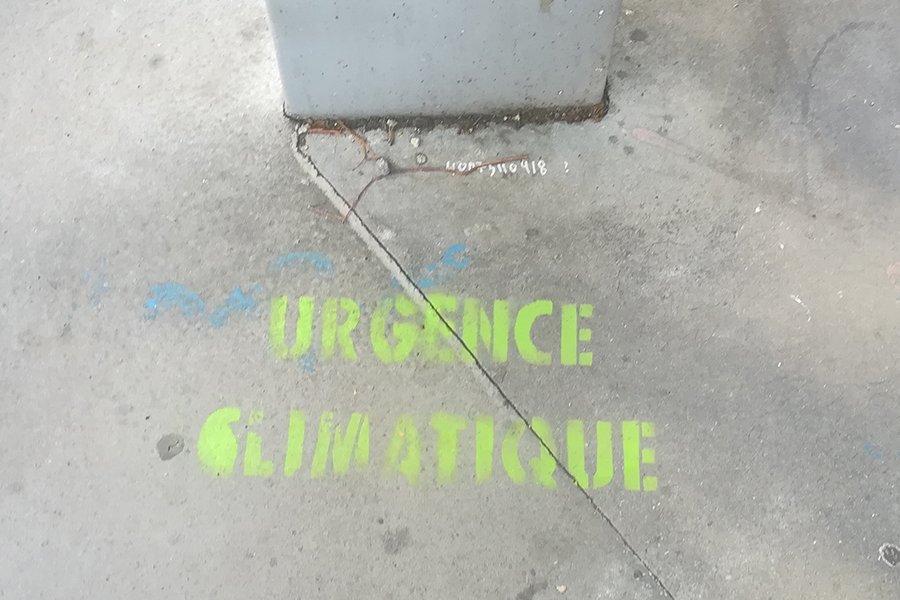Les eaux des rivières étaient si bien piégées dans les terres plates du Wisconsin qu’elles se contorsionnaient en boucles et en lacs, se diffusant au travers du paysage en larges marécages. New Lisbon était établie au bord de l’une de ces zones gonflées d’eau et son plan orthogonal venait étrangement buter sur les volutes et les courbes que la rivière découpait dans le paysage.
A Lisbonne l’eau, loin de pouvoir se répandre au travers des terres, marquait la limite précise de la ville, les collines du Chiado et de l’Alfama plongeaient dans le Tage dont les eaux se mêlaient déjà à celles de l’océan atlantique, attirant les pêcheurs et les explorateurs vers le large. Sa première soirée dans la ville portugaise, il l’avait passé à se perdre dans les rues, incapable de s’orienter parmi les pentes afin de retrouver le Tage. Quand, fatigué de sa propre incapacité à se repérer dans la ville, il avait enfin atteint les bords du fleuve, se frayant à travers les chantiers en cours un chemin vers le quai, il avait été surpris de voir que l’obscurité y régnait, la masse noire de l’eau entrainait dans l’ombre ses berges, seul un petit groupe d’immigrés et quelques rares joggeurs circulaient le long du quai.
Il était arrivé à New Lisbon avec la nuit. Attiré par les lumières d’une enseigne, il avait dîné dans un établissement situé au bord de la route principale, à l’entrée de la ville. La salle, relativement vide, était vaste, dimensionnée pour des samedis soirs plus animés à en croire les affiches placardées sur la porte d’entrée et la scène installée dans l’un des angles de la pièce. Il se cala dans l’angle opposé, à bonne distance, de manière à pouvoir observer les quelques clients venus dîner et ceux accoudés au comptoir, à proximité des écrans diffusant les matchs de football américain. C’était ne pas rendre service à la serveuse que de se tenir si éloigné et il s’en voulut un peu de la voir ainsi traverser toute la pièce afin de prendre la commande. La jeune femme était légèrement bègue et sa condition d’étranger semblait encore ajouter à sa confusion. Il voulait boire une longue bière et manger un de ces pulled pork hamburgers dont il aimait la viande effilochée et sucrée.
Il n’était pas pressé, il avait repéré en arrivant dans la ville le camping Riverside et il projetait d’aller y passer la nuit. Il pleuvait désormais, aussi ne monterait-il probablement pas la tente, préférant dormir dans la voiture plutôt que d’éprouver la sensation pénible d’un montage sous la pluie. Il irait s’installer au bout du camping, non loin de l’emplacement occupé par un homme âgé accompagné d’un tout jeune garçon. Le premier était sans doute le grand-père du second. Disposés autour de leur feu de camp se trouvaient la tente, le 4×4 et la remorque sur laquelle était arrimée la barque de pêche qui servirait sans doute le lendemain.
La journée avait été grise, chargée de l’humidité que les lacs rendaient à l’air, une lumière si éloignée de celle omniprésente qu’il avait pu rencontrer au printemps dans les rues de la capitale portugaise. Les sols clairs et les murs de la ville renvoyaient une blancheur qu’il croyait réservée au pourtour de la Méditerranée. Aussi les sensations qu’il éprouvait à la mémoire de ces deux lieux étaient particulièrement doubles et difficiles à rassembler. D’un côté les versants d’une vaste ville perpétuellement en pente, occupée d’escaliers, d’orangers et de touristes, de l’autre côté la petitesse d’une ville de 2 500 habitants, plate, environnée au nord par une large zone de marais et cernée sur le reste de ces bords par des cultures de maïs et de soja. Une ville dont le centre se résumait à la croisée orthogonale de deux rues, aux quatre angles desquels se trouvaient quatre édifices : une station essence, un supermarché, un bar et un bureau de poste. Les passants étaient moins nombreux que les voitures qui traversaient le carrefour alors que les rues de Lisbonne lui avaient semblé saturées de gens. L’une des deux villes savait être belle tandis que l’autre s’en fichait parfaitement.
L’eau restait pour lui le meilleur moyen à son esprit d’opérer le passage de l’une à l’autre. Sa nature même, informe, permettait d’inventer l’espace géographique qui aurait pu mettre ces deux villes à portée l’une de l’autre, via ce qu’il imaginait un très long voyage en barque. Mais le temps de la traversée lui aurait semblé juste au regard de la distance et de la disparité de ces deux endroits, il aurait mis entre elles ce qu’il fallait de vide et de silence pour les garder, l’une et l’autre, intactes à son esprit. C’était à son sens l’inconvénient des voyages en avion et en voiture, les aéroports et les routes mettaient entre les lieux une multitude de détails et d’évènements qu’il était difficile ensuite de soustraire au souvenir.
Pour traverser Lisbonne, parce qu’elle était immense et complexe, il avait pris pour guide un roman de Tabbuchi, Requiem, le récit d’un songe ou d’une hallucination qui avait achevé de le plonger dans un état de rêverie et de torpeur. Il parcourait la ville à la recherche des menus détails du roman, des lieux, des boissons et des plats que croisait le narrateur. Suivant un itinéraire allant du cimetière dos Prazeres à Cascais, il avait bu du Sumol et mangé de la soupe Alentejana sans que ni l’un ni l’autre ne lui parusse à la hauteur de ce que le récit laissait entrevoir. La vie réelle, toujours, lui semblait légèrement en deçà de celle des romans.
Il se souvenait qu’il cherchait des yeux les bateaux et les navires, l’évocation de ces explorations portugaises qui avaient envoyé les équipages en partance de la ville de l’autre côté du monde alors connu. Il n’en avait trouvé que peu de trace : la peinture d’un grand voilier sur une barrière de chantier, alors qu’il se dirigeait vers le Parque das Nacoes ; une caravelle reproduite sur les azulejos d’un restaurant de poisson à Cascais, alors qu’il s’efforçait de finir la feijoada qu’il avait commandé non par goût mais par souci d’être exhaustif ; les fresques baroques de la salle Vasco de Gama du musée militaire qui mêlaient les cartes du monde aux motifs mythologiques. Un dernier navire enfin, sur les murs de la casa do Alentejo, un endroit où l’on semblait cultiver la nostalgie, la retenant entre les boiseries et les parquets lustrés des salles vides.
Sans le livre de Tabbuchi, il n’aurait pas poussé la porte de ce lieu discrètement enchâssé parmi les façades de la rua das Portas de Santo Antao. Sur plusieurs étages, le bâtiment mélangeait au travers de ses mosaïques les influences mauresques à celle de l’Alentejo. Du pur ornement à la fresque narrative, elles recouvraient les murs des salles et des patios, les cages d’escaliers et les couloirs qu’il empruntait. Il circulait de pièce en pièce, poussant des portes entrouvertes sur des salles vides mais dont les tables étaient dressées, les sofas profonds et impeccables. Il parvint à un restaurant, des groupes de gens étaient attablés sous des nappes rouges, leurs discussions ne semblaient pas pouvoir perturber le silence ambiant. On avait d’ailleurs pris soin de répartir la clientèle en deux salles, la plus étroite étant réservée à l’agitation des enfants.


Le matin suivant, il fut réveillé par le bruit de la pluie qui tapait doucement sur le toit de la voiture. Le ciel était encore gris à New Lisbon. A travers le pare-brise embué, il voyait le jeune campeur et son grand-père occupés à faire cuire des pancakes au dessus de leur feu de camp. Ce dernier faisait couler la pâte de son saladier sur une plaque métallique tandis que le garçon muni d’une spatule, surveillait la cuisson et retournait les pancakes. Il entrouvrit un peu la fenêtre de la portière arrière, espérant que l’odeur viendrait jusqu’à lui et avec elle le plaisir illusoire d’un copieux petit déjeuner. Ce fut celle de l’herbe et de la terre mouillée et il dut bien admettre qu’il fallait qu’il se charge de son petit déjeuner car personne ne viendrait le régaler. Ces deux voisins échangeaient peu de mots, leurs gestes suivaient apparemment un rituel bien établi qui ne nécessitait pas de discours supplémentaires. Le silence matinal tenait encore l’ensemble du camping, les campeurs étaient à leurs tâches matinales, de leurs silhouettes il ne voyait que les épaules un peu hautes et les têtes encapuchonnées sous les parkas imperméables.
Ce n’est que lorsque le ciel parvint à s’éclaircir que l’activité commença à se faire sentir, notamment aux abords du petit embarcadère situé près de rivière. On approchait les pickups et les remorques. Une femme dont le tee-shirt rose saumoné prenait soudainement la lumière était penchée au dessus de l’eau. Elle tenait à la main une corde au bout de laquelle flottait une barque, et semblait attendre ou hésiter avant de pouvoir s’embarquer.
Alors qu’il quittait le camping, il aperçut le grand-père et son petit-fils occupés à écoper l’eau de la barque avec le même saladier que celui qui avait servi un peu plus tôt à la préparation de la pâte à pancakes.
Il ne s’agissait pas de chercher ici les traces des bateaux et des caravelles. Les colons étaient arrivés sur place par le train. Un vieux wagon, repeint à neuf, portant l’inscription Milwaukee road était postée sur le bord de la route principale, juste en face de la sortie du camping Riverside. Sur une pelouse devant un large hangar consacré aux activités du Lions club et à une association de Vétérans, l’American Legion, se trouvaient également exposés un char d’assaut et un hélicoptère de l’armée.
Empruntant la route qui passait entre les véhicules de l’armée et le wagon, il arriva sur le cimetière de la ville dont la pelouse était jalonnée de stèles et constellée de petits drapeaux. Ces derniers indiquaient les tombes d’anciens soldats. Nombre d’entre eux étaient morts lors de la guerre de Corée et très peu lors des deux conflits mondiaux. Les habitants de New Lisbon n’étaient pas revenus à l’Europe, ni par la mer, ni par les cieux. Il apprendrait plus tard que la majorité de ces soldats appartenaient à la Garde National Aérienne du Wisconsin, dont le campement se situait à quelques kilomètres seulement, sur la route qui remontait vers Eau-Claire. Il s’agissait d’une force de réserve de l’armée américaine qui avait semble-t-il été peu ou pas mobilisée entre 1914 et 1945, mais massivement lors du conflit coréen.
D’un cimetière à l’autre, il se souvenait de celui dos Prazeres à Lisbonne, où il était arrivé en pleine chaleur et après une longue marche à travers la ville. Les caveaux blancs étaient serrés les uns contre les autres et contre les cyprès si sombres qu’ils apparaissaient noirs à travers l’objectif de l’appareil photo. Il avait retrouvé son calme au fond de ce lieu, dans le carré réservé aux soldats dont les tombes rases et modestement fleuries contrastaient avec les riches et encombrants tombeaux. L’endroit formait un encorbellement sur le paysage, surplombant une étroite bande d’immeubles agglutinés, enserrés par la voie rapide et la prochaine colline.
Il s’était rendu dans ce cimetière parce que le narrateur, en nage, y rencontrait tour à tour une gitane voyante, un gardien occupé à manger dans la fraîcheur de sa loge, et le fantôme d’un vieil ami, Tadeus, avec qui il irait trop boire et trop manger. Mais aussi, devait-il se l’avouer, parce qu’il aimait se promener dans les cimetières, que ce fut en Europe ou en Amérique, y cherchant des yeux un nom, une inscription, une évocation singulière. Il cherchait également une atmosphère, un silence qu’il ne retrouvait que dans ces endroits à l’écart et les terrains vagues, des lieux dans la ville où la ville se faisait plus absente, sa rumeur plus étouffée, à la manière dont une sourdine parvenait à assourdir le son puissant d’une trompette. Il cherchait peut-être lui aussi à y rencontrer quelque fantôme ou la manifestation confuse d’un esprit particulier.
Et Lisbonne se prêtait plus facilement au jeu des apparitions que sa jumelle américaine. Il faut dire que plus retorse dans sa forme, la lumière y entrait de façon moins franche ce qui multipliait les possibilités de mise en scène. La façon qu’avait eu ce rai de lumière de se poser sur cet homme assis dont la petite fille s’exerçait à faire du vélo, la façon qu’avait eu la lune d’apparaître sur ce fleuve qui se retirait comme se retire une mer et le cercle qui s’était dessiné à la croisée du transept d’une église au moment où une femme était affairée à passer la serpillère. New Lisbon ne disposait pas de cette capacité à jouer avec la lumière, ne disposait pas de cette force de séduction. Les villes américaines étaient sans doute moins aguicheuses que les villes européennes, ou bien était-ce qu’elles ne jouaient pas du tout la même partition. Car pourtant tout, de l’Amérique, exerçait sur lui une sorte d’attraction, même si cela ne relevait pas du charme, de la langue, ou de la lumière. Et il se surprenait à aimer ce qu’il n’aurait pas aimé en des circonstances plus quotidiennes : les cafés allongés jusqu’à la dilution et servi dans des gobelets en carton, le sucre glacé et le gras moelleux des donuts de fast-food, la banalité des pavillons et du plan des villes. Il aimait les quartiers pavillonnaires aux pelouses rases que de grands arbres venaient toujours ombrager et leurs routes trop larges, dont les enrobés fissurés était rejointés à la diable par un ruban d’asphalte qui courait au sol comme un serpent affolé. Une pure apparence de simplicité qui sans doute reposait son esprit d’européen saturé mais qui ne parvenait jamais à masquer que derrière se jouait la même complexité.


New Lisbon et Lisbonne vivaient dans l’inconscience l’une de l’autre, la capitale Portugaise était bien loin de se soucier de cette petite ville américaine, et New Lisbon ne devait vraisemblablement son nom qu’à un autre Lisbon situé à 1000 kilomètres de là dans l’Ohio, d’où étaient venus les premières populations. Les colons européens avaient ainsi créé sur le territoire, au fur et à mesure qu’ils le prenaient aux indiens, une succession de ville en « new », selon un enchainement de références et d’hommages dont on avait fini par perdre le point initial, une ville outre-Atlantique, une capitale. Sur les panneaux qu’il croisait le long de la route, aux noms des villes à consonances anglaises et françaises se mêlaient ceux issus des langues indiennes. Eau-claire, Altoona, Bracket, Millston, Vaudreuil, Milwaukee. Il existait très peu de villes qui ne fussent pas nommées selon l’un de ces principes, dressant sur la carte du territoire une sorte de constat de ce qu’avait été la conquête de ces lieux. Un peuple d’immigrés européens était venu occuper peu à peu la place des peuples indiens et puisque ces derniers ne laissaient derrière eux pas de villes, pas de monuments, si peu de traces tangibles, il lui semblait qu’il ne restait d’eux plus rien que l’invisible : la langue et le nom des lieux, le nom de certaines villes sur les panneaux routiers de ce nord-est américain.
Empruntant la route en direction de Mauston, il avait tourné à gauche peu de temps après la sortie de la ville avant d’atteindre un espace de pique-nique aménagé à quelques pas d’un groupement de pavillons. En arrière plan, à la lisière du boisement, des herbes hautes couvraient des buttes de terres et cet état presque sauvage de la végétation était suffisamment rare dans ce pays de pelouses impeccables pour que cela signifia autre chose qu’un simple abandon de la tondeuse à gazon. Un panneau précisait qu’il s’agissait de tumulus indiens, des monticules aux formes parfois rondes, parfois plus complexes, à l’évocation d’animaux, bâtis par un peuple présent à partir du troisième siècle dans le sud du Wisconsin. Les informations qui suivaient étaient assez brèves, détaillant la posture possible des corps lors de leur inhumation. Il était précisé que l’on devait la conservation de ces sépultures à la générosité de M. et Mrs Earl W. Bailey et à l’action du Lions club qui entretenait ces lieux depuis 1976. Que cela ne releva d’aucune structure publique avait cessé de le surprendre, cela faisait partie des dissemblances entre les deux continents, la façon dont la culture ou l’histoire était l’affaire de l’état ou celle des gens.
Il en fit soigneusement le tour, suivant le contour net tracé par l’herbe coupée au ras de la butte de manière à en souligner la courbe. Un dessin précis sans doute assez éloigné de la façon dont à l’époque de leur édification ces buttes avaient pris forme dans le paysage et dans la forêt. Si légères que fussent ces traces, elles offraient pourtant quelque chose de visible en bordure de cette petite ville du Wisconsin. Il songeait qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que ces bosses de terres fussent rasées, tondues et ratissées. Leur permanence semblait ne tenir qu’à la volonté de quelques fondus d’histoire locale.
Il n’avait pas croisé suffisamment de gens, et il n’aurait sans doute pas su quoi leur dire mais il aurait aimé voir un peu qui étaient ces quelques gens qui avaient décidé de maintenir cet endroit et de l’entretenir. Il ne savait pas que la bibliothèque locale gardait parmi son fonds une collection de pointes de flèches dont il ne verrait que plus tard les reproductions photographiques. Parmi les images publiées en ligne, une photo en noir et blanc montrait un homme accroupi devant des panneaux de bois sur lesquels étaient fixées les pointes de flèches, à la manière dont on épingle les papillons. L’homme s’appelle Harry Mortensen et la photographie doit dater des années 60, période durant laquelle l’homme passait une partie de son temps libre à chercher dans le paysage ces petits morceaux de pierre taillée, rassemblant petit à petit plus de 4000 objets dont certains ont la forme évidente d’une pointe, les bords dentelés taillés au plus fin et au plus coupant afin de mieux entrer dans le cuir et la chair du gibier tandis que d’autres morceaux, plus ovales et moins ciselés, pouvaient aisément passer inaperçus, perdus parmi le sables, les cailloux et les galets de la rivière.
De la rivière, il avait à nouveau rejoint les rives. Non pas ces larges marais d’herbes et d’eau que les barques de pêcheurs et les canoës parcouraient, mais à cet endroit, en aval de New Lisbon, où la rivière était plus étroite et plus brune, bordée d’arbres qui la rendait plus ombreuse et dont les branchages anciens finissaient par tomber et se laisser emporter, s’entassant par paquets à la première saillie de la roche. Le soleil et le passage répété de l’eau les avaient poncés et rendus d’un gris argenté que le ciel encore nuageux venait rendre plus velouté. Il se disait que de tous les paysages contemplés que les indiens avaient contemplés, celui de cette rivière, malgré son inconstance et sa variation inhérente à l’état de l’eau, était peut-être le plus à même d’être resté inchangé.
Accroupi parmi les rochers, il se souvint alors de cet autre moment, quand, attablé de l’autre côté du Tage, il regardait Lisbonne depuis l’autre rive, depuis cet endroit qu’il avait trouvé après avoir marché le long de ce quai aride, bordé d’entrepôts abandonnés et de parois de béton immense, occupé à de rares endroits par quelques lanceurs de cannes à pêche, ceux que l’on croise toujours dans ces lieux un peu à l’écart, ces bordures de canaux et de fleuves déclassées, car ils peuvent y saisir dans une relative tranquillité le poisson qu’ils mangeront le même soir. Il avait au bout de ce quai finissant en impasse, trouvé un petit café calé contre le coteau, dont les tables disposées le long de l’eau invitaient à s’y asseoir et à s’y déchausser, les pieds sur le muret qui séparait le quai d’une minuscule plage, et à renouveler des heures durant la commande afin de ne pas avoir à s’en aller.


Crédits photographiques ©Armande Jammes