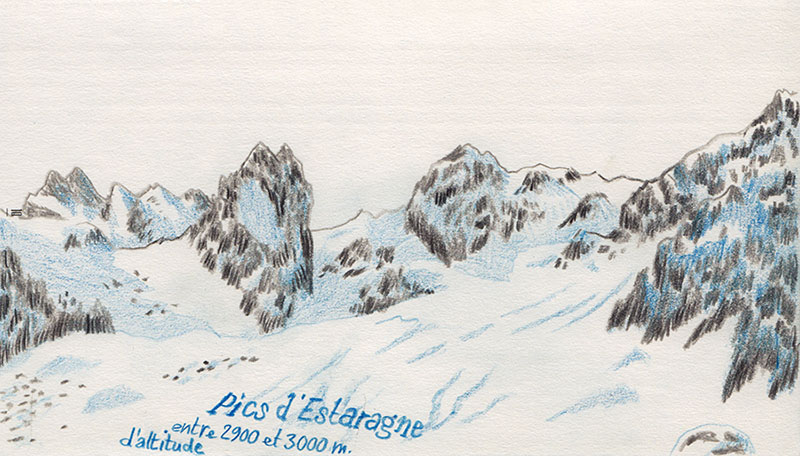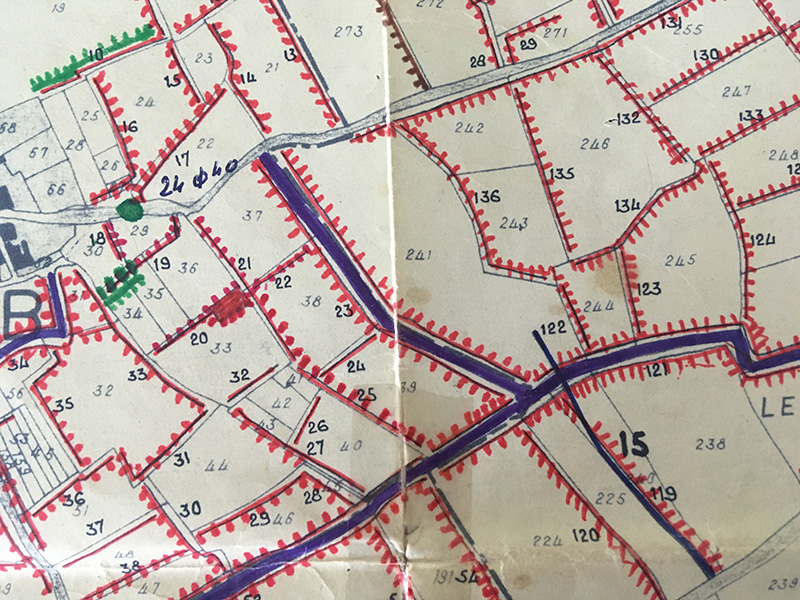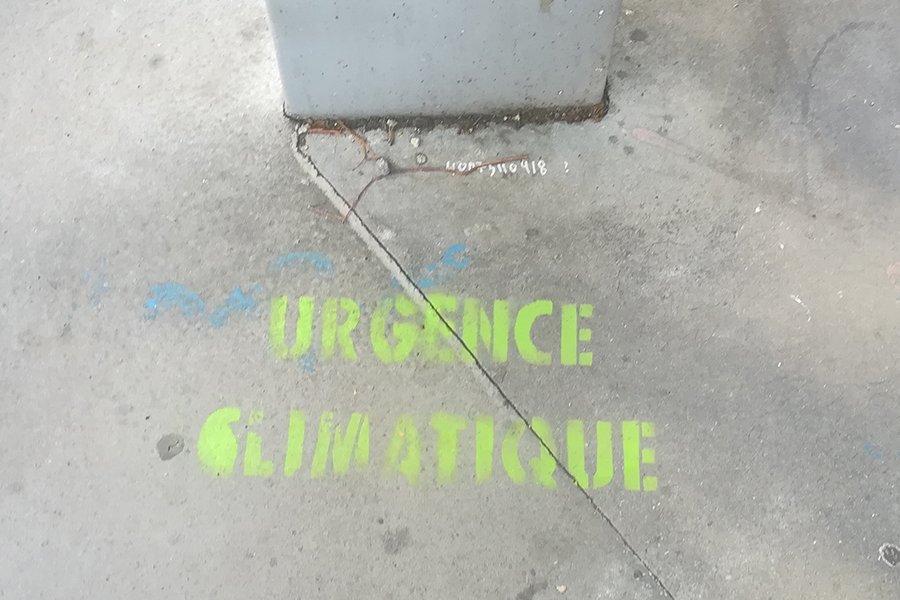Derrière la mousseline des rideaux, il voyait bouger les ombres des ouvriers affairés à rénover la façade. Le vitrage devait être simple car leurs voix lui parvenaient.
Il était bien à la Nouvelle-Orléans. La veille en arrivant, il avait été surpris de la taille de la ville, il s’attendait à quelque chose de plus petit, les routes se superposaient les unes aux autres dans la nuit, il n’avait pas tellement préparé sa venue, il n’était pas sûr de retrouver l’hôtel.
La traversée de la Louisiane avait été assez monotone, le long de l’autoroute qui venait du nord du Texas. Les boisements de part et d’autre de la route lui masquaient le paysage et l’empêchaient de voir plus loin. Il aurait voulu tout embrasser d’un coup, les marécages, le Mississipi, les maisons blanches en bois avec leurs balancelles sous le porche d’entrée, les stations essences fatiguées. ll aurait voulu voir et ainsi vérifier d’un coup tout ce que les films et les livres lui avaient planté dans le crâne, insidieusement, les images d’un pays à la fois proche et lointain. Mais la route, par égard peut-être envers toute cette imagerie qu’il s’était construit, n’offrait que son infini ruban de bitume.
Il savait par ailleurs qu’il n’aurait pas beaucoup de temps devant lui pour voir la ville, deux ou trois jours à peine, que c’était trop peu, trop court, un peu idiot, que l’on ne voit pas une si grande ville en deux jours, mais enfin en combien de temps peut-on la voir. Il savait déjà qu’à toutes les questions posées, avez-vous vu les bayous, les clubs de jazz, avez-vous mangé cajun, il dirait oui enfin non, j’ai fait ce que j’ai pu, j’ai vu ce que j’ai pu, et ce n’est pas assez. Mais enfin j’ai vu la vieille France, le vieux carré et ses bâtisses ceinturées par des balcons de saloons où des femmes en jupon n’apparaissaient plus, mais de jeunes filles hilares qui jetaient des colliers de perles de plastique aux pieds des touristes. J’ai vu les rues étroites et les arrière-cours parmi lesquelles se faufilait dans les romans la pègre mais je n’ai pas vu la pègre. Je n’ai vu que des gens tranquilles se promener. Je suis allé manger des beignets saturés de sucre glace au café du monde, parmi les familles américaines, les grands-mères permanentées et leurs petits fils et filles. Les familles américaines où les gens sont si grands, si gros, si vastes, qu’il avait l’impression d’assister à l’avènement d’une nouvelle civilisation, d’une nouvelle espèce humaine où l’homme moyen aurait été multiplié par 1,3. Et à les voir ainsi se remplir de sucre et de café, il se disait que c’était un peu dingue de tant manger, quand la moitié, ou peut-être le quart suffirait à vivre. Qu’avaient-ils à tant dévorer, quel appétit, quelle soif de vie pouvait être la leur. Assis à coté d’eux, les doigts plongés dans le sucre des beignets et sur la anse blanche de la tasse pleine d’un café brûlant, il se sentait petit, sans faim, sans voracité, doutant de lui, incapable de tout comprendre et de tout exprimer. Etait-ce cela la grande différence entre l’Europe et l’Amérique du Nord, le manque et l’excès d’appétit.
Quelques mois plus tôt Il était à Orléans, assis sur un banc de pierre à regarder passer la Loire. Loire contre Mississipi, tant de i, tant de s. C’était surtout le mot, sifflant et superbe qui le transportait, davantage que cet énorme flot d’eau boueuse qui coulait maintenant devant lui. Il évoquait une langue lointaine à la sienne de latin et de grecque et lointaine aussi à l’anglais. Ce mot, il l’apprendrait plus tard, appartenait aux Ojibwés, le peuple qui vivait sur ces terres avant l’arrivée des colons. Il lui semblait que ces peuples indiens, l’histoire américaine cherchait à les voir sans totalement y parvenir. Dans les musées qu’il avait pu visiter aux États-Unis, la part qui leur était accordée était toujours assez succincte, jamais omise mais étrangement inerte. Les colons avaient peut-être coupé trop durement à la racine cette histoire quand en arrivant sur ces terres ils avaient voulu réinventer un monde, ne faisant au final que reproduire les formes qu’ils connaissaient, leurs vies venues d’Europe. Cette partie leur avait alors échappé, si bien qu’ils n’avaient peut-être plus les moyens de la raconter.


Il n’avait passé qu’une seule journée à Orléans. Au regard des populations respectives il y avait une certaine logique, la ville de la Nouvelle-Orléans comptait trois fois plus d’habitants que celle d’Orléans. Cela faisait une journée pour environ 114 000 têtes. Cela était par contre sans rapport aucun avec leur étendue, la ville américaine multipliant par 33 la superficie de la française. Il faut dire que beaucoup d’eau, de routes, de marais venait diluer la densité américaine.
En descendant du train ce matin-là en gare d’Orléans, il avait décidé puisque c’était la Toussaint de commencer sa visite par le nord, par le grand cimetière. Ainsi n’aurait-il plus ensuite qu’à se laisser descendre vers la Loire. Le plan du cimetière était en amande, sa forme semblait issue de la courbe des routes au milieu desquelles il se logeait. Vide ou à peu près, les seules personnes qu’il croisait étaient des femmes, affairées à nettoyer les tombes. Se pouvait-il que ce soit si vrai, que les hommes meurent plus tôt, ou que les femmes seules se soucient de l’entretien des tombes. Il préféra se concentrer sur le crissement du sable que faisait chacun de ses pas. Les tombes étaient nombreuses, leurs stèles se superposant les unes aux autres dans l’épaisseur de la perspective. Ici repose Rogello, le magicien des ombres, ne l’oubliez pas. Au milieu du cimetière passait une route bordée d’érables jaunissant, une voiture de temps en temps circulait.
Continuant sa descente vers le centre-ville, il traversa des quartiers d’habitats, des tours hautes de logements. Il rêvait déjà des tours américaines, de leur fierté, de l’insolence qu’elles afficheraient au coeur des villes. Le soleil ce matin, dans sa grande clémence, lui montrait celles d’Orléans sous un jour charmant, leurs façades prenaient le soleil. Il faut dire que le timing n’avait jamais été le même entre les deux continents. Quand la Nouvelle Orléans fut fondée en 1718 et que l’on entreprit de dessiner son plan en tablette de chocolat, Orléans avait déjà vu passer pas mal de batailles et de peuples, passer les Anglais et Jeanne d’Arc, amassé pas mal d’argent et de vieux hôtels particuliers. Les églises étaient en places, leurs flèches dessinaient la ligne d’horizon. Les tours et grands immeubles ne viendraient que beaucoup plus tard, une fois que la fascination américaine aurait agit dans les inconscients. Il se demandait si tout cela n’était pas une affaire de jalousie entre vieux cousins. Envieux peut-être de nos cathédrales, ils avaient bâti leurs tours au centre de leurs villes. En mauvais copieurs on avait bâti les nôtres en périphérie. Les villes à se contempler les unes les autres avaient fini par s’hybrider.


Arrivé dans le tissu médiéval serré, il s’était trouvé devant la grille du musée historique qu’une simple plaque de métal signalait. Dans une cour étroite il poussa une porte en bois. Trois personnes, deux femmes derrière la banque d’accueil et un homme en costume de gardien, interrompirent leur discussion levant sur lui des sourires de bienvenue. L’affluence en semaine ne devait pas être très importante et peut-être s’ennuyaient-ils un peu. Deux salles du musée seulement étaient ouvertes, l’une consacrée à Jeanne d’arc, l’autre au trésor de Neuvy-en-Sullias. Jeanne d’Arc lui filait toujours un peu le cafard. Depuis l’enfance et les récits qu’il en avait lu, ces histoires de pucelles, de voix, de sorcières, de bûcher le déprimaient. Les trésors étaient plus réconfortants. Découvert par des ouvriers le 27 mai 1861 à quelques kilomètres d’Orléans, celui de Neuvy-en-Sullias se composait de sculptures en bronze datant de la période gallo-romaine. La salle était petite, aux murs étaient suspendus de longs morceaux de tissus sur lesquels figurait l’histoire des lieux. Il aurait adoré être cet homme-là, celui qui voit apparaître sous la pioche ou la pelle l’anomalie d’une forme, l’agencement étrange de la roche, de la brique qui forme une cachette et s’effondre, sentir sa surprise et son incompréhension face à cette tête de cheval mêlée de sable, de terre et de bois décomposé qui se dessine dans l’ombre.
S’il ne se trompait pas dans les dates, ce coup de pelle à 30 km d’Orléans était plutôt simultané avec le début de la guerre de Sécession aux Etats-Unis. La Nouvelle-Orléans rassemblait ses troupes de confédérés sans savoir qu’elle entrait dans une longue période de guerre et de feu. La France, pour sa part était relativement au calme, calée dans le Second Empire, et M.Mantellier, directeur du musée historique de l’Orléanais, pouvait contempler à l’envie ces objets qui venaient de passer 1800 ans sous terre. S’était-il aussi étonné de voir que de telles sculptures, une telle précision en même temps parfois qu’une telle stylisation avaient existé et cohabité à cette époque.
A quoi s’était-il attendu ? Peut-être à des fragments de pièces, à des écus, à des broches, des peignes, mais sans doute pas ces énormes animaux. Ces grands sangliers, ce cheval parfait et ce petit cerf, un peu trapu peut-être mais droit dans ses bottes à jamais. De ces animaux jusqu’à nous, il existait une telle continuité de forme que le temps s’en trouvait rétrécit. Lorsque les colons américains, à considérer qu’ils eussent le temps en cette période affolée de leur histoire, contemplaient l’artisanat des peuples indiens, qu’il fut contemporain ou vieux de 5000 ans, un gouffre devait s’ouvrir dans le temps. Alors peut-être se sentaient-ils infiniment étrangers en ces terres qu’ils habitaient, se sentaient-ils infiniment nouveaux.
Ces derniers temps, dans ses promenades et dans ses lectures, il croisait souvent des cerfs et des sangliers, qu’ils fussent chassés par les rois, par les hommes et leur chien, ensauvagés et merveilleux. Ou bien était-ce son œil et son esprit, attirés, qui s’arrêtaient sur ces animaux en particulier.
C’est à l’un d’entre eux qu’il devrait l’apaisement de sa colère quand à la Nouvelle Orléans, abruti de fatigue, il rejoindrait en tramway son vieil hôtel du carré français.
Ce jour-ci avait été difficile, il avait tenté en vain de prendre un bus pour rejoindre le lac Pontchartrain dont il voulait voir le rivage, absolument. Il avait longtemps marché à travers le parc, jusqu’à ce qu’à ce que ses jambes lui fassent mal, comme à chaque fois. Une douleur qui montait des talons jusqu’aux hanches, les signes d’un rappel à l’ordre venu des profondeurs de sa personne, le squelette se rappelait au cerveau. Et à mesure que la fatigue le prenait et que la lumière baissait, son humeur sombrait invariablement. Les matins, les sorties de train, les sorties d’hôtel étaient toujours précieuses, le plaisir d’être en promenade, en excursion. Chaque fin de jour était alourdie par la conscience de ne pas avoir tout vu, de ce qui manquera, d’avoir vu une ville qui pour être mythique n’est qu’une ville, qu’elle ne donne rien de plus que ce qu’elle a et que c’est en soi qu’il faudra puiser les ressources pour la raconter. Enfin ce jour-là, après avoir attendu un bus pendant une heure peut-être, assis sur le trottoir d’une banlieue résidentielle de la Nouvelle-Orléans, regardant passer les voitures dans la lumière désormais biaise qui filtrait entre les roues, le bus ne venant pas et hésitant sans cesse entre attendre ou partir, rebroussant enfin chemin, parcourant à l’envers la route, il s’arrêta un instant prendre une boisson dans une station essence, un énorme verre de coca-cola rempli de glaçon. Alors qu’il réglait sa consommation, levant les yeux au dessus de l’épaule du vendeur, il vit glisser dans l’espace laissé entre les affiches qui tapissaient la vitrine, la silhouette d’un bus à l’arrière duquel brillait un 60. Il en resta un instant ahuri, mortifié que cela finisse ainsi, que ce seul moment d’absence fut celui qu’avait saisit ce foutu bus pour passer.
La consolation vint alors d’un grand cerf posté sur une fausse colline, un mausolée, à l’angle sud du cimetière de Greenwood, là où se termine la ligne de tramway qui le ramènerait vers le centre. Il se découpait sur le ciel désormais orangé de la fin du jour.
Le tramway finit par arriver quand le cerf n’était plus qu’une ombre chinoise sur un ciel désormais gris. Le chauffeur s’amusant de son air chiffonné lui fit une mauvaise blague. C’est la fin du service, vous allez devoir rentrer à pied. Son large dos soulevé par le rire, il se lança alors dans une manœuvre d’inversion des sièges en vu du départ prochain. De manière assez ingénieuse, le dossier des banquettes en bois coulissait au dessus de l’assise, inversant ainsi le sens des bancs de façon à ce que les voyageurs soient toujours dans le sens de la marche. Ce tramway, mieux appelé Sreetcar, datait du dix-neuvième siècle et était une véritable attraction dans la ville. Mal installé sur le siège de bois, il repensait au tramway d’Orléans qui circulait dans la ville silencieusement comme un grand serpent lisse et doré, aux collégiens qu’il avait vu courir Place de l’Etape pour l’atteindre avant que ne se ferment les portes automatiques. Il semblait plus aisé de saisir en marche ce petit objet roulant au milieu de Canal Street, il n’aurait d’ailleurs pas été surpris de voir surgir dans ce but Eddy Valiant et Roger Rabbit, coursés de prêt par des fouines hystériques et solidement armées.
Sur la route du retour, alors que toutes les fenêtres du wagon étaient baissées et que l’air délicieux de la Louisiane consolait les passagers fatigués, un camion chargé de gros béton les dépassa avant que le battant de sa remorque ne cède sous le poids du chargement. Celui-ci vint se répandre sur la chaussée dans un fracas bien particulier, celui du béton qui racle la tôle et s’écrase au sol dans un bruit lourd et mouillé.


Crédits photographiques ©Armande Jammes