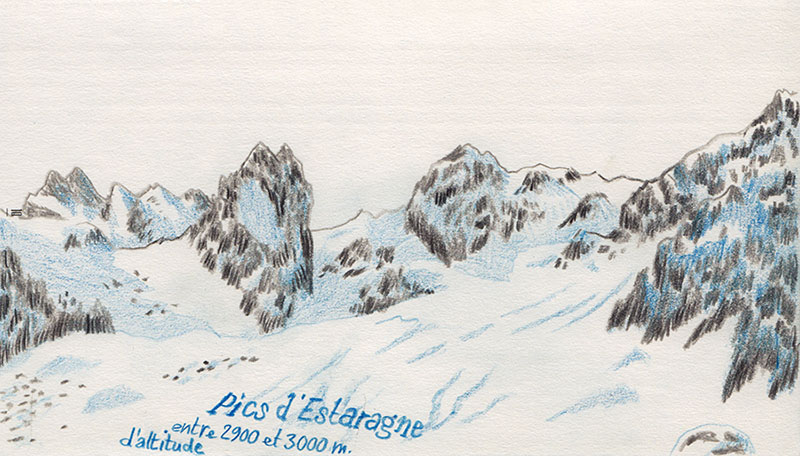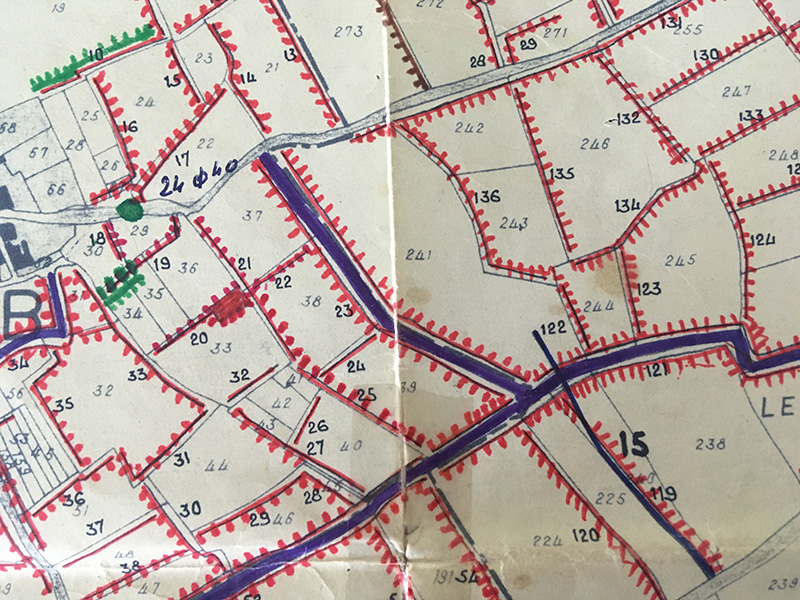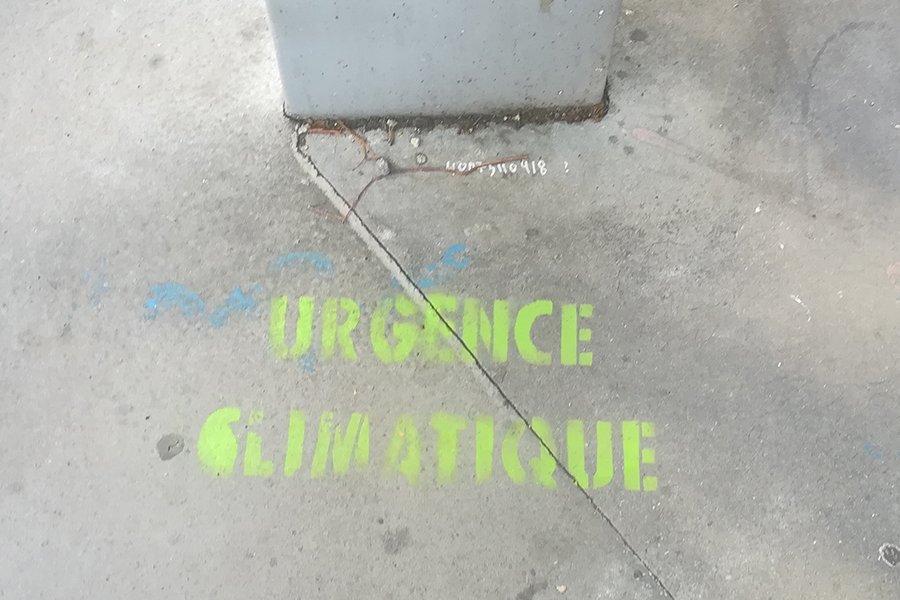Les feux tricolores jaunes se balançaient au centre de l’image, leur teinte était assortie au marquage de la route ainsi qu’à la façade qui faisait l’angle des deux rues. Cette première image n’évoquait rien, à priori, de celle qu’il avait consciencieusement gardé de Carlisle, dans un coin de son esprit, pour pouvoir mentalement les superposer. L’image en bichromie d’une ville rouge brique posée sur le vert gorgé d’eau et de chlorophylle des pelouses anglaises détrempées.
Cette journée américaine s’annonçait brûlante et la dureté du soleil semblait vouloir écraser le souvenir même de ce qu’était l’humidité, ce qu’elle mettait de coton dans le ciel gris et de lueur sur la brique mouillée. Pour ne pas se laisser ainsi assécher, il s’appliqua à repenser le début de cette autre journée écoulée paresseusement dans un train silencieux qui filait vers le sud à travers la campagne écossaise toute roussie et brune par le passage de l’automne. Le visage posé au plus près du vitrage sur lequel la pluie courait en lignes obliques et rapides, il avait savouré de voir l’eau ainsi tenue à distance, pour un temps qu’il savait compté.
Ici l’air était sec et les couleurs s’en trouvaient presque abîmées, altérées comme elles l’étaient parfois dans les films qui se déroulaient aux Etats-Unis, ce qui lui laissait cette légère impression d’évoluer dans l’un de ceux qu’il aurait pu regarder. Bien qu’habitué, depuis quelques semaines qu’il voyageait, à les voir ainsi suspendus aux balcons et aux mâts des maisons américaines, la profusion des drapeaux lui fit penser à un défilé ou à quelque cérémonie nationale. Sans doute aussi l’animation de la rue qui tranchait avec le calme et le vide apparent des villes jusque-là traversées. De part et d’autre de la voie se trouvaient installés des étals de marché dont ceux de quelques vendeurs de légumes mais leurs bancs étaient si petits que cela semblait plutôt être la production issue d’un potager que celle d’une exploitation maraîchère. Sur la route qui lui avait fait traverser l’Indiana et l’Ohio il n’avait croisé que de grandes exploitations céréalières, dont il ne voyait que les champs et les silos, jamais les occupants et pas la moindre trace d’une culture légumière. Il y avait aussi un boulanger, qui proposait des pains à la mie dense et sucrée comme un gâteau et quelques femmes qui vendaient des ouvrages de crochets et de tricots. Il se demandait s’il ne voyait pas dans ce marché les premiers signes de la présence de la communauté Amish, dont il savait se rapprocher.
Il acheta à leurs stands de quoi se faire un repas, cherchant des yeux un peu d’ombrage. Il y avait peut-être un espace, à quelques mètres de lui, sous l’auvent de ce qui pouvait être un bar mais un homme s’y était installé avec sa guitare et il y chantait fort et faux. Quittant la rue principale il s’engagea au hasard dans l’une des rues perpendiculaires bordées de maisons. La trame de la ville était régulière, quadrillée avec précision, il croisait une nouvelle rue dès qu’il avait compté quatre maisons.
La ville américaine et la ville anglaise avaient un peu de brique en commun, il trouvait néanmoins que la seconde s’accommodait mieux des climats pluvieux. De toute façon, New Carlisle à l’inverse de la ville anglaise n’en avait pas fait un principe constructif. Passée la rue centrale, on trouvait les habituelles maisons de bois aux bardages horizontaux, peintes en blanc ou dans des teintes toujours claires. Des maisons qui ressemblaient à des mobil-homes ou à des versions plus vastes mais moins massives de la cabane du colon. Les petites villes américaines qu’il avait traversées étaient pour la plupart d’entre elles bâties en bois ou avec un matériau qui imitait ce principe de bardage. Articulées autour d’une rue principale, leur organisation n’était pas si éloignée de celle que l’on voyait dans les westerns, la poussière et le saloon en moins. Les façades de planches de bois emboîtées les unes au-dessus des autres semblaient fines et fragiles, il pensait qu’un gros coup de vent suffirait à les souffler. Il y avait finalement si peu de pierre, si peu de béton. Un Américain rencontré la veille lui avait rappelé que le peuple américain, restait, au sein de son territoire, un peuple mobile, alors peut-être que ces maisons, légères à construire et légères à déconstruire, étaient bâties pour une seule génération.
De quatre maisons en quatre maisons il était parvenu au bout de l’une des rues de ce quartier pavillonnaire. La voie s’infléchissait finalement pour laisser la place à un parc dont la pelouse formait un grand creux au milieu duquel se trouvait quelques grands arbres, quelques jeux d’enfants, des bancs et des tables sous une sorte de préau. Il put enfin s’asseoir pour manger le repas qu’il s’était acheté, un mélange d’avocats, de tomates et de concombres émincés et roulés dans une galette de maïs.
De Carlisle il gardait le souvenir, inversement dense, inversement resserré, de constructions solides. Les façades des maisons étaient en continuité du revêtement de la rue et l’ensemble donnait l’idée d’une masse rouge et compacte que rien, ni le vent venu des plateaux de l’Ecosse ni la pluie venue de l’océan, n’auraient pu souffler. Le château non plus ne semblait pas vouloir se hisser trop en hauteur et prêter ainsi le flanc aux attaques du mauvais temps, ses murailles épaisses dominaient à peine la ville. Certaines des rues du centre-ville étaient couvertes, s’articulant à des passages souterrains en un long centre commercial, comme si la ville avait fini par se couvrir de toitures ou se terrer et noyer peut-être son chagrin dû à la pluie dans une frénésie de commerces dont les lumières chaudes inévitablement vous attiraient. Il se souvint qu’à peine descendu du train, il était lui-même rentré dans le premier café dont l’ambiance lui avait semblé assez chaleureuse, repoussant ainsi davantage le moment où il lui faudrait affronter la pluie. Il s’était assis à la table voisine de celle occupée par trois jeunes anglaises dont les visages étaient particulièrement maquillés. Elles discutaient avec vivacité, tout en tartinant de beurre et de confiture les scones qui accompagnaient leur café. Il en avait lui même commandé, trop heureux de pouvoir profiter de ce qu’il considérait comme une gourmandise de vieille anglaise. Il aurait pu rester là des heures, au chaud, à observer ces voisines de table ainsi que le ballet des autres clients, bercé par le bruit des discussions, de la machine à café et celui des tasses entrechoquées.
Pour échapper à la pluie toujours, il était ensuite rentré dans une église, emboîtant le pas à la femme en costume qui déambulait lentement sous la nef, les bras croisés dans le dos, comme le font souvent les gens qui laissent tranquillement s’écouler les heures. Puis il avait rejoint le hall d’un musée qu’il n’avait ni vraiment le temps, ni l’envie de visiter et s’était subitement retrouvé à quelques pas d’un légionnaire romain buvant son café, cuirassé, le buste moulé dans l’acier et le haut des cuisses couvert d’une jupe métallique. Derrière lui, des femmes en toges blanches vinrent à passer.

Carlisle se situait à une cinquantaine de kilomètres du mur d’Hadrien dont le tracé se situait plus ou moins au niveau de la frontière entre l’Ecosse et l’Angleterre. Il avait vu dans la ville des panneaux qui mentionnaient son ancien tracé et il avait suivi la direction qu’ils indiquaient. Lassé dès lors de vouloir échapper à la pluie, il s’était résigné à l’humidité qui l’avait entièrement gagné, l’eau ayant fini par plaquer son jean sur ses cuisses, il éprouvait finalement cette sensation qu’il avait redouté et qu’il détestait. Pour ne pas trop y penser il cherchait à rassembler mentalement le peu qu’il savait de l’histoire anglaise. Il n’était jamais parvenu à tout à fait comprendre ce qu’étaient précisément ces entités complexes de Grande Bretagne et de Royaume Uni, ne sachant jamais qui, de l’Irlande, de l’Ecosse, du Pays de Galles appartenait à quel groupement. Aussi avait-il aussi oublié que l’Angleterre avait fait partie de l’empire romain, jusqu’à cette limite pourtant célèbre que constituait le mur d’Hadrien. Cela expliquait sans doute la présence de ce légionnaire Romain buvant son café dans le hall du musée.
Il se disait tout en mangeant qu’il n’était pas facile, trois années après, de trouver dans les rues de New Carlisle quelque chose qui tint la comparaison avec tout ce petit bazar historique de château, de mur d’Hadrien et de Rome Antique. Une fois encore la ville américaine se détachait de la ville européenne par cette absence apparente d’épaisseur historique. Le seul élément qu’il avait pu voir dans la ville était cette petite plaque apposée sur la façade du bâtiment situé à l’angle des rues Jefferson et Main Street. Ici, disait la plaque, John Dillinger avait braqué sa première banque le 10 Juin 1933. Bien que discrète, la plaque était soignée, son graphisme traduisait un certain goût pour le romanesque, un sentiment mêlé de fierté et de gravité au sujet d’un évènement dont on ne savait pas apparemment s’il fallait, si cela était bien raisonnable, se féliciter. Collant son nez à la vitrine, il avait vu des locaux apparemment inutilisés, une pièce propre et parquetée dont les meubles étaient vides. Subsistait néanmoins une grande photographie au-dessus de la cheminée sur laquelle on pouvait voir en grand la façade de la banque dans laquelle on venait d’entrer. Elle n’était aujourd’hui plus tout à fait la même, la partie en bois du rez-de-chaussée ayant été depuis remplacée par une haute colonnade. Le temps s’était-il arrêté au moment de ce braquage ? L’histoire de New Carlisle existait pour l’instant autour de ce célèbre bandit qui, dévalisant ici sa première banque avait offert à la ville un petit morceau de récit, qu’elle continuait à cultiver.
Son déjeuner terminé, il se dirigea vers un boisement qu’il avait repéré de l’autre côté du parc et qui offrirait peut-être un peu de fraîcheur. Il lui avait fallu passer dans ce qu’il pensait être un jardin privé pour rejoindre l’allée en pente qui descendait vers un paysage difficile à identifier, une petite forêt clairsemée. Certains arbres étaient décharnés, sans branchage presque et sans feuillage à la manière de ce qui resterait d’un bois qui aurait brûlé, à la différence que les troncs étaient clairs au lieu d’être calcinés. A travers ces fûts élancés et les hautes herbes, il voyait au fond de ce qui était une petite vallée la ligne claire d’un lit de rivière asséché, sans doute constitué de galets. Pas d’eau, peu de bruit, peu de vent, quelque chose d’inquiet, sans passants ni joggeurs. Le paysage qui l’entourait, trahissait son dénuement.
A Carlisle, il ne s’était jamais senti ainsi isolé. Même alors que la pluie ne voulait cesser et que ses pas l’avaient emmenés dans ce parc situé au nord de la ville, de l’autre côté de la bosse formée par le château. Il y avait alors devant lui deux anglaises, entièrement capotées de matières imperméables qui se promenaient accompagnées par un chien. Il les avait suivies alors qu’elles s’engageaient sur le chemin de sable, taché des feuilles tombées et de flaques. Et même alors qu’ils longeaient le décor inanimé d’une fête foraine, il n’avait pas senti une si grande immobilité. Les manèges à l’arrêt, outrageusement fluorescents et les stands aux rideaux fermés étaient latents de l’énergie qu’ils s’apprêtaient à déployer, chargés des cris mêlés de joie et de frayeur, des odeurs de sucre et d’huile chauffés.
Alors que là, soudain seul en lisière de ce boisement dans cette petite ville américaine, il ne parvenait pas à rétablir l’idée du mouvement. Il finit par remonter, vaguement asphyxié, à la surface et reprit définitivement de l’air au niveau des quartiers pavillonnaires après avoir pu s’assurer, à la vue d’un homme occupé à jardiner, que le monde était encore animé. Ce léger malaise était peut-être dû à la chaleur, aussi renonça-t-il à l’affronter. Il rejoignit sa voiture et entrepris de sillonner la ville, protégé par l’air conditionné. Il se mit à rouler doucement, une rue après l’autre, s’attachant à entrevoir quelque chose de la ville anglaise dans les rues de cette ville de l’Ohio.
De New Carlisle il garderait aussi des souvenirs éparpillés. Celui d’un minuscule cimetière aux stèles penchées, au milieu d’une pépinière de conifères dont les formes taillées en cônes ou en cubes se brouillaient peu à peu sous l’effet de la repousse ; celui, à une autre extrémité de la ville, d’un second cimetière immense et planté d’autant de pierres que de hauts arbres ; celui d’une piscine municipale vidée mais dont la simple tache bleu pâle apportait l’illusion de la fraîcheur. Le souvenir aussi d’un grand silo, pris au milieu de la ville, dont la silhouette lointaine lui avait d’abord fait croire à un château. Un château gris, grand, haut, composé de cylindres et de cubes et des treillis en métal qui venaient s’y accrocher.
Un possible château qui eut partagé avec celui de Carlisle une certaine sobriété de forme et de matériau, à la différence que celui-ci était élancé et vertical quand celui de Carlisle déroulait sa muraille de brique sur la courbe de la colline herbue qui le supportait, faisant émerger une tour trapue et basse, découpée de larges créneaux.
De château c’eut alors été le troisième, puisqu’il y avait eu celui, fait de cartons et de planches qui s’était dessiné tout au fond du parc anglais, à l’endroit où le bois se refermait sur la grande pelouse centrale. Un faux château sur lequel on avait tracé avec soin la ligne claire des joints entre les briques et autour duquel étaient disposés un certain nombre de faux personnages. Il se souvenait d’un cheval blanc qui lui faisait face et dont la tête trop étirée et étroite semblait avoir été serrée dans un étau. D’un cheval noir placé de profil, surmonté par la silhouette approximative d’un cavalier dont la forme avachie était menacée par la flèche d’un archer placé en haut de la scène, à l’abri des créneaux. Au tout devant du tableau, il en était presque certain car le dessin de son costume était soigné, autant peut-être que celui de l’homme qu’il avait croisé au musée, se tenait la silhouette aplatie d’un légionnaire romain tenant un drapeau.
Ainsi avait-il compris, à voir le bûcher que deux hommes bien réels s’affairaient à préparer, entassant à l’arrière du château planches et palettes, et à voir les nombreuses caisses rassemblées, les barrières et les rubans de chantier, que s’annonçait pour le soir même une grande fête et qu’il n’en verrait que la préparation.
Aussi s’efforçait-il de regarder New Carlisle avec précision, de peur de laisser passer une information ou une occasion qui eut été déterminante, regarder avec soin les affiches et les panneaux de circulation, regarder les façades car certains bâtiments ne laissaient rien entrevoir de leur fonction. Il finit par découvrir la bibliothèque de la ville au détour de l’une des rues, un petit bâtiment placé en retrait d’un parking. Il poussa la porte avec timidité et se dirigea vers l’accueil, rompant à remord avec la quasi clandestinité avec laquelle il se déplaçait depuis quelques heures dans la ville américaine. On le conduisit vers une petite salle dans laquelle se trouvaient les archives de la ville, quelques cartons de journaux et de brochures éditées lors de fêtes et de célébrations. Il resta un long moment à feuilleter les documents qui revenaient sur les évènements qui ponctuaient la vie de New Carlisle. Il finit par trouver la photographie d’un article du Dayton Daily News daté du 21 juin 1933. L’article titrait simplement que 10 000 dollars avaient été dérobés. Le nom de Dillinger, encore inconnu, n’apparaissait pas. Au milieu des colonnes de texte, une photo montrait trois personnes qu’il s’imagina être les employés, qui d’après les sous-titres avaient été ligotés. Deux hommes et une femme, un peu mal à l’aise apparemment de se retrouver ainsi exposés.
Se trouvait également parmi les brochures un autre article rédigé par un certain Jesse C. Barnhart qui revenait sur la fondation de la ville sans précisément la dater. Un ancien membre de l’expédition Lewis and Clark (une expédition qui partant de Saint Louis dans le Missouri avait rallié par voie de terre la côte pacifique et dont il ne cessait, dans ses recherches de voir la mention) un certain John Paul était, selon l’auteur, le premier colon à s’être installé dans la région. Mais de cet homme il n’apprit rien de plus, si ce n’est que son fils et sa fille le virent un jour se faire assassiner, avec tout le reste de la famille, par un groupe d’Indiens. L’auteur précisait que ce massacre avait été l’un des derniers troubles entre les Indiens et les colons et le récit abandonnait à ce moment le portrait de la famille Paul pour nous détailler le nom des peuples Indiens, faisant rapidement glisser son récit vers la figure de Tecumseh.
Ce nom, Tecumseh, il se souvenait l’avoir déjà croisé. C’était le nom que l’on avait donné à ce petit sentier sur lequel, quelques heures plus tôt il s’était senti subitement isolé. Il apprit alors que Tecumseh était un Shawnee né en 1768 à quelques kilomètres de la ville, près d’un lieu nommé Picqua. D’après l’auteur il avait été un grand chef et un grand stratège, cherchant à réunir les nations indiennes de cette partie du territoire, les Miamis, les Chinchinnas, les Foxes, afin de les rendre plus forts face aux indépendantistes américains. L’article revenait sur l’enfance et les combats de Tecumseh mais devenait soudain confus, ou était-ce qu’il ne comprenait pas bien, car il lui semblait que le récit racontait et à quelques lignes d’intervalles deux versions opposées de la mort de l’Indien. Etait-elle survenue sur le champ de la bataille de la Thames au Canada, alors qu’il avait rejoint là-bas les Anglais qui combattaient les Américains ou s’agissait-il d’une mort naturelle et d’une sépulture oubliée quelque part, non loin d’ici, du côté de l’Ecole Tecumseh.

C’est parce qu’il avait décidé de suivre cette seconde piste qu’il avait quitté la bibliothèque et pris la route vers l’est. Après quelques kilomètres, il était arrivé à hauteur d’une école en brique, un bâtiment allongé, étiré au fond d’un grand parking qui devait chaque jour se remplir de jeunes Américains venus étudier. De part et d’autre du bâtiment et du parking se trouvaient de larges pelouses, l’ensemble était clôturé par un grillage lui empêchant tout accès. Si les restes du Shawnee étaient quelque part, il espérait que ce ne fut pas sous la large plaque d’enrobé mais un peu à l’écart dans un creux ou une bosse de la pelouse, afin qu’au moins le reste de ses os, si ce n’était son âme, puisse un peu respirer, piétiné sans doute par des étudiants mais pas chauffé à blanc sous le bitume et sous les voitures qui devaient s’agglutiner.
Remontant dans sa voiture il avait continué à rouler vers l’Est, alors que la lumière déclinait et que la chaleur se faisait plus douce, avait ralenti à l’approche de ce qui avait dû à un moment de l’histoire être New Boston, dont il avait lu, l’après-midi à la bibliothèque, dans un entrefilet qu’il ne restait plus rien de cette ville que des sépultures. Il était arrivé alors sur les lieux non pas d’un cimetière mais d’un important rassemblement de voiture garées dans un large pré pris entre deux voies. Sur la gauche, un groupe de personne s’affairait autour d’un camion de pompier débouchant depuis l’allée d’un parc. Au-dessus une large banderole tendue annonçait The New Boston Fair en ce week-end de Labor Day. Il comprenait enfin pourquoi, en ce jour de fête nationale, il y avait autant de drapeaux, pourquoi ce marché, pourquoi ce chanteur qui chantait faux et pourquoi peu à peu ce grand silence qui s’était fait au coeur de l’après-midi, à moins que ce ne fut l’ombre planante de Tecumseh.
Se garant parmi les voitures, il se faufila incognito à l’inverse du mouvement de départ ambiant et remonta la pente qui menait vers le parc. Il se trouva soudainement au milieu de soldats et d’Indiens. Ils étaient peut-être 200, 300 ou plus, déguisés avec un soin extrême, évoluant au milieu de larges tentes blanches. C’était la fin de la journée, de la soupe était servie dans des chopes et fumait depuis les chaudrons.
Elle se tenait là, la fête américaine qui répondait, trois ans plus tard, à celle de Carlisle, la ville anglaise. Cette fois-ci il arrivait non plus avant mais après. Il n’avait pas vu le château s’embraser en Angleterre et il n’avait pas non plus assisté à la reconstitution de la bataille de Picqua entre les Américains et les Indiens. Mais cette bataille avait-elle eut lieu, peut-être n’avait-on fait qu’en mimer les préparatifs et le campement, car il ne subsistait nulle part, ni dans le paysage, ni sur les visages, les traces d’un éventuel affrontement. Peut-être que le plus touchant était là, dans le relâchement des figurants, tous vêtus encore de leurs costumes, les longues jupes des femmes et les coiffes, les guêtres des hommes, les redingotes, alors que la chaleur qui avait dû les abattre avait laissé place à la douceur du soir, aux rayons obliques du soleil s’abaissant. Un homme coiffé de plumes, vêtu de jambières de cuir traversait devant lui la pelouse.
Placé sur un rocher, à un endroit situé en surplomb du campement, un écriteau refaisait le récit de la bataille menée le 8 aout 1780 par les troupes américaines du colonel Rogers Clark contre un groupement de Shawnee, de Delaware, de Mingo et de Wyandot. Au terme d’une bataille de plusieurs heures les Indiens avaient perdu. Cet endroit avait gardé le nom du colonel américain, pourtant Picqua était aussi le lieu ou était né Tecumseh. Il avait 12 ans lorsque le combat eut lieu. C’était peut-être la perte de cette bataille qui avait marqué le jeune garçon et l’avait incité à chercher cette union indienne qu’il n’avait jamais réussi à pleinement construire, et à prendre ensuite le parti des Anglais contre les Américains, et à perdre toujours puis à mourir, selon la deuxième version de l’article, sur ce champ de bataille canadien. Et c’était peut-être de cette rancune tenace à l’égard de ces assaillants qu’était née la légende. Tecumseh aurait, dit-on, jeté un sort aux futurs présidents des Etats-Unis. Les plus malchanceux d’entre eux qui seraient élus au cours d’une année en zéro mourraient de mort violente. Une légende qui trouvait aujourd’hui ses preuves et ses contradictions dans la longue liste des présidents assassinés, des grands malades que l’on avait aussi pu empoisonner et des rescapés d’attentats ratés.

Crédits photographiques ©Armande Jammes